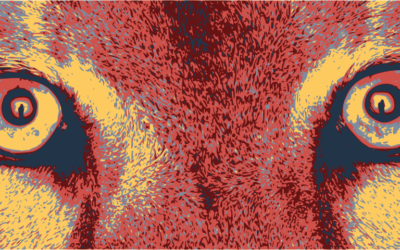La biodiversité est en baisse mais est-il pertinent d’appréhender cette baisse comme une crise ?
NOS ARTICLES
SUR LES transitions
En dehors des logiques partisanes.
Les articles que vous découvrirez sur cette page son issus de nos réflexions menées tout au long de nos expériences respectives. Nous revendiquons l’exploration car nous croyons au bien fondé de questionner et d’expérimenter. Aucun dogme n’est a priori admis ici y compris la science qui est instrumentalisée et qui n’apporte pas de fondement moral décisif pour prendre des décisions.
DES RÉFLEXIONS ORIGINALES
L’invention des limites planétaires
Vues comme scientifiquement établies, les limites planétaires sont une invention arbitraire qu’il convient de questionner pour agir.
L’origine animale des pandémies !
Si nous ne changeons pas notre rapport aux autres animaux, nous n’éviterons pas de futures épidémies , avec toutes les conséquences que nous connaissons désormais.
Kaïros : le moment opportun de changer son alimentation
Souhaitons-nous allouer davantage de ressources à la gestion de crises épidémiques où préférerons-nous réorienter notre alimentation pour maximiser nos chances d’évitement ?